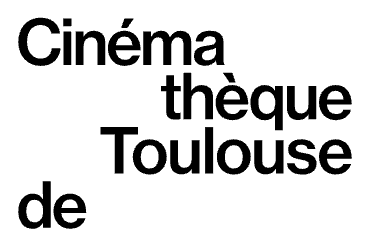Béla Tarr

Béla Tarr, habiter le monde
Il est vénéré par Gus Van Sant et Martin Scorsese, qui dit de lui qu’il est un des artistes les plus audacieux du cinéma. Alors si Martin Scorsese le dit, on peut lui faire confiance et l’on ne peut pas passer à côté de son œuvre magistrale. Une œuvre que les cinéphiles connaissent et reconnaissent pour ses longs plans-séquences millimétrés et son noir et blanc unique, lumineux bien qu’il peigne la profondeur sombre d’un effondrement. Magistrale, parce qu’après Le Cheval de Turin (2010), qui sera son ultime fiction, il décide délibérément que ce sera son dernier film. Acte aussi fort que définitif d’un artiste qui ne fait pas des films pour faire des films, mais qui se retire considérant son œuvre achevée. Une œuvre qui se déroule sous nos yeux comme un long poème homérique, quelque chose d’une Odyssée du XXe siècle, chaque film étant une partie d’une même et seule épopée à travers laquelle une humanité en déshérence cherche à habiter le monde. Un parcours tendant vers la cosmogonie, où l’on part d’un besoin d’habiter dans le monde pour arriver à l’acceptation d’être habité par le monde. Du Nid familial, son premier film, où il est question d’absence de logement et de fuir un foyer parce qu’il est invivable, au Cheval de Turin, où une maison, que l’on ne parvient pas à quitter parce qu’elle offre une protection contre les éléments à l’heure de l’extinction, s’érige comme le lieu dépassionné où l’on attend la mort en réitérant les gestes simples d’un quotidien que l’on croirait sans fin.
L’œuvre de Béla Tarr est hypnotique. Elle s’offre en une circularité – il ne s’est jamais caché de faire le même film, chacun étant une variante découlant du précédent – qui se referme sur elle-même, mais pas tout à fait au même point. Comme on le verra, dans Rapports préfabriqués, reprendre la première séquence en fin de film en une boucle qui n’en est pas une : la même chose et à la fois autre chose. Imprimé par un mouvement de cycle, immuable, comme celui des saisons, comme celui de l’histoire. D’une histoire matérialiste (Béla Tarr est né et a commencé le cinéma dans la Hongrie communiste) à un temps quasi mythologique où l’extinction de l’humanité, dans une apocalypse sans cris, serait le point de départ du monde d’avant les hommes. Les mouvements de l’histoire. Une histoire de mouvements.
Pour cela, on partira d’un réalisme brut, social plus que socialiste, dans un style qui puise au cinéma direct, vérité, et qui surprendra les Tarrphiles initiés à ses longs et enivrants plans-séquences en quête d’épure. Jusqu’à Damnation, et surtout Sátántangó, et le versement dans une calme intranquillité œuvrant pour une résignation libératoire, la caméra sera fiévreuse, à l’épaule, et les plans serrés, dégageant une sensation de claustrophobie, d’enfermement. Spatial. Social. Mental. Des cadres enserrant en gros plans des visages comme pris dans l’étau d’un ordre social (travailler, fonder une famille…) qui les étouffe, en même temps qu’il traduit le désir de la caméra de percer un vertige existentialiste qui sourd de regards mélancoliques. Ces regards qui ne peuvent être que mouillés de mélancolie parce qu’ils sont la fenêtre d’un ailleurs, qu’ils sont revenus d’un ailleurs qu’ils ont vu et que l’on ne voit pas encore mais d’où l’on sent pointer le trouble d’un mystère profond qui n’attend pas de réponse. Van der Keuken disait que l’on regarde les choses comme si on regardait un mur, mais que l’on veut regarder derrière le mur, sans savoir s’il y a quelque chose derrière ce mur. Le réalisme des premiers films de Béla Tarr a quelque chose de ce mur dont parle Van der Keuken. Et son style si particulier, qu’il développera par la suite, sera une manière d’aller regarder derrière le mur. Mais pour regarder derrière le mur, il faut commencer par regarder ce mur. Le fixer du regard. Le fixer par le regard. Ou, si l’humanisme est un existentialisme, l’humanisme de Béla Tarr est un réalisme. Approcher l’être humain dans sa solitude. Cerner la solitude de tout individu d’être humain. Simplement humain. Le scruter, le sculpter peut-être, avant de danser avec. Et l’on verra qu’il n’y a pas de rupture entre ses premiers et ses derniers films, mais un glissement progressif d’un réel vers un sur-réel, dans une suite de variations en quête d’harmonie sur la difficulté à habiter le monde. C’est beau, sombrement beau. Et c’est vertigineux.
Franck Lubet, responsable de la programmation